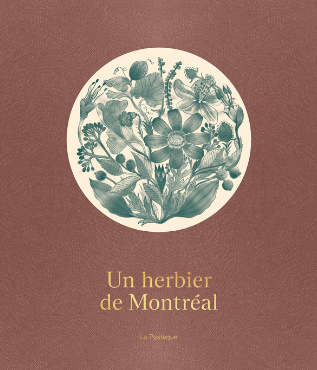La classe de Madame A : Le territoire intérieur
On dit qu’il faut prendre soin de soi pour le rendre ensuite aux autres. En tant qu’enseignante, c’est beaucoup d’âmes qu’il faut écouter et soigner. De là l’importance de trouver un endroit pour laisser parler son propre cœur et entendre ce qu’il a à nous dire.
Depuis des années, c’est sur mon tapis de yoga que j’apprends à être moi. C’est aussi là que j’ai rencontré mes plus beaux modèles d’enseignantes. Perrine, Valérie, Karelle. Des femmes qui m’ont inspirée à être, un souffle à la fois, un peu plus en moi.
Le yoga, c’est avant tout des images portées par un souffle. Combien de fois ai-je refait les poses du pigeon, de l’aigle ou de l’arbre en tentant d’être une meilleure humaine à travers celles-ci? Des postures alliant force, équilibre, alignement et ouverture. Les bases de ce qu’il faut projeter devant les êtres qui nous sont confiés et à qui on a plus à apprendre que l’ABC.
Si être une meilleure humaine semble parfois difficile, former des humains constitue une mission pouvant paraitre impossible. Ce l’est d’autant plus en sachant que les enseignants nomades sont nombreux, changeant de classe, de niveau, d’école et même de matière d’une année à l’autre. Comment s’enraciner sans être étourdi par la vastitude des terres à cultiver?
Cette année, c’est dans la position de la montagne que j’ai décidé de jouer mon rôle d’enseignante. Rien d’aussi impressionnant que les inversions qu’il est possible de faire sur un tapis de yoga. Mais qu’importe. C’est dans l’enracinement que j’accueille jour après jour mes élèves, tout simplement. Et je me rappelle la raison pour laquelle je choisis chaque année de revenir dans ce territoire riche qu’est ma classe : ma foi profonde en le pouvoir rassembleur des mots et l’espoir de voir ceux-ci fleurir dans la vie de mes élèves.
*
Hiver. Le soleil est couché, mais je suis encore dans ma classe à découper des poèmes pour mes élèves. Une drôle de cohorte que je n’ai réussi à intéresser à rien avant aujourd’hui. Tant pis pour les mystères de la langue et les textes bien construits. Contre toute attente, il aura suffi d’un poème d’Élise Turcotte pour en éveiller un, puis deux, puis trois. « Pourquoi, Madame, est-ce qu’elle a le droit d’écrire comme ça, Élise? » Si seulement j’avais compris plus tôt que c’est en marge des mots que je parviendrais à les toucher!
Un à un, je colle les morceaux de papier sur les dossiers des chaises. Demain, on s’installera sur nos pupitres pour lire les poèmes. On travaillera la langue dans sa forme la plus libre pour comprendre comment la structurer. S’il le faut, ces ados trouveront des mots chaque jour sous leur chaise ou dans leur casier. Jusqu’à ne plus pouvoir s’en passer.
*
Il y a cette petite que j’ai aimée dès le premier jour. Elle lisait dans le couloir le midi pour éviter de manger seule au milieu des autres. Je lui ai proposé de diner en classe. Peu à peu, elle m’a parlé des arbres et des oiseaux qu’elle dessinait. Alors, je lui ai apporté Un herbier de Montréal, cet ovni publié chez La Pastèque alliant poèmes et dessins rendant hommage aux arbres de l’ile qu’est Montréal. À coups de barres tendres et de livres, on a développé une confiance, une sorte d’amitié. Et puis, par un midi d’hiver, j’ai tenu la rencontre du club de lecture dans la classe. Timidement, les semaines aidant, elle a pris part aux échanges. Enfin, un matin, elle m’attendait avec sa plante : « Je l’ai sauvée parce qu’elle était brisée et j’ai pensé que vous l’auriez fait aussi. Elle sera bien dans votre classe. » Puis elle s’est envolée et je me suis rappelé pourquoi j’étais encore là.
*
Dans un épisode de Proxémie[1] (La Fabrique culturelle), Joséphine Bacon, poète innue, explique qu’elle n’aurait jamais vécu à Montréal si elle n’avait pas conservé en elle son territoire, sa culture et sa langue. Ses mots ont trouvé écho chez moi. Et s’il fallait retrouver le territoire qui sommeille en nous? Et si revenir à cette culture, cette langue qui nous a fait choisir notre métier, constituait le meilleur moyen de demeurer enraciné?
Quelque part
Dans le Nutshimit
Je suis chez moi
Sans adresse réelle
Ma rue s’appelle chemin de portage
Bacon, J. (2018). Uiesh. Quelque part. Montréal : Mémoire d’encrier, p. 120.
La poésie prend une place de plus en plus grande dans ma vie et ma classe. Les poèmes, comme les positions de yoga, me permettent de me recentrer et de canaliser diverses émotions en images. Cette forme d’expression rejoint aussi le besoin d’instantanéité des adolescents, mais, surtout, celui de laisser une trace à leur façon.
*
C'est la folie dans les couloirs et je fais partie de ceux qui courent. En chemin, je croise un élève de l’année précédente. Il faut le dire, les ados devenus grands oublient souvent de sourire et parfois même que j’existe encore. C'est aussi ça, être en troisième secondaire. Et pourtant, l’élève relève la tête:
- Madame, j'voulais vous remercier pour la carte que vous m'avez envoyée cet été. Ça m'a fait full plaisir, pis j'vous l'ai jamais dit.
Il y a des moments comme ça où même Madame A cesse de courir dans les couloirs. Juste pour sourire.
*
Après chaque année scolaire, je me réfugie aux Iles-de-la-Madeleine. En marge du monde, j’entame juillet en enfonçant mes orteils dans le sable pour résister au vent du large. Tranquillement, j’essaie de laisser aller l’année, un souvenir à la fois, enracinée quelque part.
Au début de l’été, c’est de là-bas que j’écris des cartes postales à mes élèves. Cela fait partie du rituel. Prendre en note les adresses, choisir les photos. Des couchers de soleil époustouflants, des champs de fleurs à perte de vue, des bateaux de pêche accostés aux quais. Ensuite, j’écris à chacun. Doucement. Dans le micro-espace de la carte, je leur parle du bleu du ciel et du bonheur de retrouver la mer. Surtout, je leur souhaite ce que je n’ai pas su leur dire de vive voix. Je leur rappelle de rester forts, de croire en eux, d’être vrais. Toujours, je signe Mme A xxx.
Au fil des jours, la dame du bureau de poste de Bassin me reconnait. Elle me salue avec son drôle d’accent :
- Encore des mots pour tes élèves?
- Oui, j’ai presque fini. Vous n’auriez pas d’autres cartes à vendre?
- On n’en a plus, ma p’tite fille! Ça fait longtemps qu’y’a pu personne qui envoie ça, ces affaires-là!
Beau temps, mauvais temps, elle colle soigneusement les timbres sur mes cartons bleuis d’encre. Et je respire mieux. Quand tous mes « Je pense à toi » ont pris la mer, je peux enfin oublier les noms, les visages, les histoires. Faire le vide et regarder loin devant. Je sais que, sur le continent, mes mots prendront le relais pour un moment.
En cours d’année, il y en a toujours un ou deux pour m’apostropher :
- Vous avez oublié d’écrire votre adresse pour qu’on vous réponde, Madame!
Alors, il me faut expliquer encore que c’est le propre d’une carte postale. Immanquablement, je repense à la dame du bureau de poste. C’est peut-être vrai qu’il n’y a plus personne qui envoie ça, ces affaires-là.
*
La classe est étonnamment fébrile. Les élèves rédigent des poèmes qu’ils mettront en scène en fonction de thématiques personnelles. Pour les inspirer, je leur ai présenté une série de recueils dont quatre très beaux publiés chez La Bagnole[2]. Je m’approche d’un groupe de garçons. Ils feuillettent Bagages, mon histoire :
La luciole se pavane dans la nuit
L’enfant bruyant la remarque
Il voit que dans l’obscurité
Il y a la lumière
Même ici
Loin de l’Uruguay
J’ai gagné le futur
J’ai perdu le passé
Je profite du nouvel éclairage
Hernan Farina Forster dans Bagages, mon histoire. Montréal : La Bagnole, 2018, p. 10.
- Est-ce que l’immigration, ça va avec la poésie, Madame?
- Tout va avec la poésie.
- On voudrait se séparer les étapes dans nos textes: les raisons, le départ, le voyage et l’arrivée dans le nouveau pays.
- C’est une belle idée.
- Est-ce qu’on pourrait ajouter des vers dans nos langues pour que vous sentiez nos pays dans les poèmes?
« Sentir nos pays dans les poèmes. » Je trouve cela beau et complexe à la fois. Et je ne peux m’empêcher de revenir au territoire intérieur de Joséphine. Il n’y a pas qu’elle et moi qui avons besoin de le retrouver.
*
Février. En remontant les chaises sur les bureaux, je remarque un manuel dépassant de l’un d’eux. Je m’accroupis et fige soudainement devant l’étonnant spectacle qui s’offre à moi.
Sous les pupitres se cache une forêt de livres ouverts. Des histoires à peine entamées ou presque terminées dispersées sur les tablettes. Des couvertures écorchées, des pages repliées. Des univers infinis dans lesquels plonger pour mieux respirer à l’abri des regards.
Je pense à toutes les fois où je répète à chacun de regarder l’écran de son ordinateur plutôt que son clavier pour travailler et je souris. Tout ce temps, ce n’est ni sur leur clavier ni sur leur écran que mes élèves se concentraient, mais bien sur les rivières de mots chantant sur leurs genoux. Ils lisaient. Heureux problème, que je me dis.
Je reste longtemps sur le plancher à regarder leur monde sous cet angle et j’ose espérer que les mots, dans leur vie, vibreront toujours autant que dans la mienne, sinon plus.
____________________
La chronique « La classe de Madame A » est publiée dans la revue Lurelu (www.lurelu.net). Les chroniques « Un livre comme un radeau » et « Laisser sa trace », lesquelles ont été fusionnées et modifiées pour la présente publication, sont initialement parues au printemps 2018 (volume 41, numéro 1) et à l’automne 2018 (volume 41, numéro 2).
Marie-Andrée Arsenault vit parmi les histoires. Auteure pour les petits, enseignante pour les grands, elle ne compte ni les mots ni les heures. La chronique « La classe de Madame A » témoigne de sa passion pour la langue française qu’elle partage jour après jour avec les élèves qui colorent drôlement bien sa vie.
[1] https://www.lafabriqueculturelle.tv/balados/21/proxemie
[2] Je vous invite fortement à découvrir, aux éditions de La Bagnole, Haïti, mon pays (2010) ; Mingan, mon village (2012) ; Hochelaga, mon quartier (2015) et Bagages, mon histoire (2018).
Par Marie-Andrée Arsenault, enseignante de français
Chronique publiée le 3 février 2020