Balayer [la guimauve] devant sa porte
 Source de l'image : http://augredemesfantaisies.eklablog.com/liebster-award-2015-a119169326
Source de l'image : http://augredemesfantaisies.eklablog.com/liebster-award-2015-a119169326
Le 1er novembre dernier, Olivier Barbarant signe dans Le Monde Diplomatique un article à charge intitulé « De la guimauve pour la jeunesse ». L’astérisque qui accompagne son nom nous apprend qu’Olivier Barbarant est à la fois « écrivain et inspecteur général de l’éducation nationale » et l’on ne sait trop si c’est en tant qu’écrivain ou en tant qu’inspecteur général de lettres qu’il signe cette tribune sévère avec la littérature pour la jeunesse. L’article fait réagir les professionnels. L’auteure Alice Brière-Haquet, déjà montée au créneau lorsqu’une chronique de Christophe Honoré avait mis à mal la littérature pour la jeunesse, publie sur son blog personnel un droit de réponse hélas partiellement anonyme, puisqu’il est signé du « Collectif des ConFiseurs et ConFiseuses de la Littérature (constitué d’auteurs, d’autrices, d’éditeurs et d’éditrices jeunesse) », qui a le mérite d’ouvrir le débat. Ce sont les termes de ce débat que je souhaiterais examiner ici, parce que l’article comme les réactions qu’il suscite (notamment sur Facebook) me paraissent révélateurs de la situation ambiguë de la littérature pour la jeunesse actuelle.
Commençons par reprendre l’article de départ. Il commence par ce « chapeau » :
« Éduquer, instruire, divertir : il y a toujours eu des livres à destination de la jeunesse qui ont, selon les valeurs propres à leurs destinataires, choisi entre ces objectifs. Aujourd’hui, tout un pan de cette littérature entreprend de diffuser un conformisme tiède, incitant à l’acquiescement aux normes tout en cherchant à intégrer le précieux marché des programmes scolaires. »
Si l’on se fie à cet avant-propos, l’article semble se présenter comme une charge contre les livres pour enfants actuels qui, contrairement à leur prédécesseurs, ne feraient plus de choix entre les objectifs différents que sont « éduquer », « instruire » et « divertir » – objectifs que l’article semble envisager comme exclusifs les uns des autres1 – et se seraient, de fait, transformés en véhicules d’une morale conformiste et aliénante. Circonstance aggravante, ces livres infiltreraient l’Éducation Nationale. À lire ce chapeau, il y a de quoi s’inquiéter. On s’attend, connaissant la réputation du Monde diplomatique, à des révélations sur de sournoises stratégies de pénétration des consciences enfantines à l’insu des vigies de l’institution éducative.
« Édition » ou « littérature » ?…
Or la lecture de l’article lui-même laisse une impression bien différente. Le premier paragraphe retrace brièvement la légitimation de la littérature pour la jeunesse dans les décennies 1980-1990 ; le suivant aborde la question sous un angle économique, rappelant les progressions de chiffres d’affaire, les succès de Montreuil, etc, pont-aux-ânes de tout article journalistique portant aujourd’hui sur ce secteur. Ce faisant, Olivier Barbarant se livre à une première confusion qui étonne de la part d’un auteur de poésie, bien placé pour ne pas confondre littérature et édition.
En effet, dans le premier paragraphe, il rappelle que le processus de légitimation de la « littérature de jeunesse » ne s’est pas fait sans heurts : « Ses succès lui ont alors permis bénéficier, non sans débats, d’une reconnaissance symbolique attachée jusqu’alors à la seule « grande » littérature. » Or le deuxième paragraphe démarre par le pronom « elle » qui renvoie toujours à l’expression utilisée dans la première phrase, la « littérature de jeunesse »: « Mais elle est aussi devenue un acteur économique considérable : deuxième secteur éditorial en France (1), un chiffre d’affaires en progression (+ 5,25 %, contre – 3,88 % la littérature dite « générale » en 2016). » Il y a là une confusion regrettable. Comment mélanger en effet, sous un même vocable, un secteur éditorial tout entier avec la désignation d’une seule de ses parties, la plus susceptible de ce processus de légitimation qui semble poser problème à Olivier Barbarant ?
Si l’on devait déplacer le regard de la littérature « de jeunesse » à la littérature « dite “générale” » (je reprends les termes mêmes de l’article), on se mettrait en situation de rapprocher les chiffres de vente de l’édition (incluant les succès populaires de Cinquante nuances de Grey, des romans de Harlan Coben et Guillaume Musso, etc.) avec le fait que certains auteurs contemporains bénéficient aujourd’hui d’une légitimation qui les fait entrer dans les pratiques scolaires, aux côtés des grands classiques du programme du bac comme Racine ou Marivaux (par exemple, Élégies documentaires de Muriel Pic, aux éditions Macula, proposé aux lycéens et apprentis dans le cadre d’un programme financé, en région Centre, par Ciclic). Ça n’a rien à voir, n’est-ce pas ? Que la littérature « dite générale », dans son infinie diversité, se vende bien ou mal, que son chiffre d’affaire brut soit en progression ou en déclin n’intéresse que les économistes et ceux pour qui l’argent est la clé de compréhension de tout. En revanche, l’entrée, éventuellement favorisée par des initiatives publiques ou privées, de certains textes dans le corpus des ouvrages étudiés en classe, voilà qui peut susciter l’intérêt d’un inspecteur général de lettres, soulever son inquiétude, interroger le glissement de valeurs que révèle une telle « légitimation » (si tant est qu’être adoubé par l’Éducation Nationale puisse encore être considéré comme une « légitimation »). Mais à quoi rime le fait de rapprocher les deux observations ? Peut-être est-ce tout simplement une déformation assez caractéristique de cette élite française (Olivier Barbarant est un normalien, agrégé, auteur d’une thèse de doctorat consacrée à Aragon, auteur « légitime » s’il en est) qui considère que là où il y a argent, il ne peut y avoir valeur.
Ce rapprochement liminaire, raccourci facile qui prétend voir une corrélation là où il n’y a que concomitance, augure mal du reste de l’article. C’est dommage, car un élément de compréhension du phénomène qui agace Olivier Barbarant est pourtant bien caché là quelque part…
La suite de l’article précise quelle est la cible d’Olivier Barbarant : non pas toute la littérature pour la jeunesse, mais précisément celle qui a, sur le plan générique, son équivalent dans la littérature générale, ou plus précisément encore, dans cette toute petite fraction de la littérature générale qui mérite d’être sanctuarisée par l’institution scolaire, et que, sans recul aucun, il désigne dès les premières lignes par l’expression « la seule “grande” littérature« . Olivier Barbarant, en effet, trie, à partir de ce troisième paragraphe – comme s’il avait enfin entrevu que la référence aux chiffres bruts de l’édition jeunesse, ou de la fréquentation du salon de Montreuil, n’avait pas grand sens, tant est grande la différence entre un cartonné pour bébé et un roman pour young adult, un documentaire sur les dinosaures, un album sans texte ou un récit pour lecteur débutant. Donc désormais, l’article se concentrera sur les romans destinés aux enfants de 8 à 15 ans, avec un objectif qui se précise à mesure que l’on progresse dans la lecture : démontrer que ces romans n’ont pas leur place à l’école, ou plutôt au collège (car on va bientôt restreindre la focale un peu plus encore : dans le 9e paragraphe, il sera question du « cycle 3 (du CM1 à la 6e) » et du « cycle 4 (de la 5e à la 3e) »). Sont donc exclus de la diatribe les albums pour les plus jeunes, dont Olivier Barbarant (qui a peut-être de jeunes enfants ? ou le souvenir de leur avoir lu des albums… dans les années 1990) célèbre la créativité, en citant deux albums unanimement considérés comme de grande valeur : De la petite taupe qui voulait savoir qui lui avait fait sur la tête de Werner Holzwarth et Wolf Erlbruch (1989), et L’Album d’Adèle de Claude Ponti (1986), qualifié tout simplement de « déflagration pataphysique ».
Torchons et serviettes
Que l’auteur de l’article souhaite concentrer ses critiques sur un genre littéraire précis (le roman) et un destinataire identifié (l’enfant qui a l’âge d’être au collège, précisément ce qui constitue la préoccupation professionnelle d’un inspecteur de lettres) me semble sain. Qu’il prenne la peine de le comparer avec un autre genre (je parlerais d’ailleurs plus précisément d’un autre medium), l’album, visant un lecteur plus jeune et sortant donc de son domaine de compétences, voilà qui me semble cohérent aussi. Encore faudrait-il comparer, là aussi, des objets culturels comparables. Or qu’avons-nous en présence ?
 À ma gauche, deux albums considérés aujourd’hui comme des « classiques », au plein sens du terme : parce qu’ils sont suffisamment anciens, au regard de l’histoire éditoriale (années 1980), pour avoir fait leur preuves sur plusieurs fournées d’enfants, mais aussi parce que, comme tout « classique », ils méritent d’être « étudiés en classe ». En effet, le site officiel Eduscol, sous-titré « Informer et accompagner les professionnels de l’éducation« , présente ainsi une liste d’albums à étudier dès le cycle 1 de la maternelle, avec cette formule sans ambiguïté : « Permettre à chaque élève de l’école maternelle de découvrir la langue par la fréquentation régulière, quotidienne, d’œuvres choisies est une pratique déterminante dans l’accès à une première culture littéraire« . On en déduit donc que les albums mentionnés dans cette liste sont des œuvres littéraires. Le document complémentaire, intitulé « Pourquoi et comment s’est opérée la sélection ?« , est plus précis encore. Il indique que face à « la grande créativité et le caractère proliférant » de « l’édition jeunesse », qui peuvent « déstabiliser ou même rebuter des adultes et des enfants éloignés culturellement de leur usage », l’institution se devait d’opérer une sélection raisonnée. Les deux albums cités sont présents sur cette liste. En résumé, lorsqu’Olivier Barbarant cite De la petite taupe… ou L’Album d’Adèle, il évoque des œuvres qui, au sein de leur genre/medium, ont fait l’objet d’un tri qualitatif de la part de l’institution, tri sélectif leur octroyant de fait le statut de « classiques » constituant une « culture littéraire » commune. Bref : de la « grande littérature », même si elle est pour les tout petits. Notons au passage que, de manière assez étrange et qui mériterait qu’on s’y arrête, les auteurs d’albums sont finalement plus facilement reconnus par l’institution que ceux qui écrivent des romans pour les enfants : Tomi Ungerer recevra la légion d’honneur ce 1er janvier 2018…
À ma gauche, deux albums considérés aujourd’hui comme des « classiques », au plein sens du terme : parce qu’ils sont suffisamment anciens, au regard de l’histoire éditoriale (années 1980), pour avoir fait leur preuves sur plusieurs fournées d’enfants, mais aussi parce que, comme tout « classique », ils méritent d’être « étudiés en classe ». En effet, le site officiel Eduscol, sous-titré « Informer et accompagner les professionnels de l’éducation« , présente ainsi une liste d’albums à étudier dès le cycle 1 de la maternelle, avec cette formule sans ambiguïté : « Permettre à chaque élève de l’école maternelle de découvrir la langue par la fréquentation régulière, quotidienne, d’œuvres choisies est une pratique déterminante dans l’accès à une première culture littéraire« . On en déduit donc que les albums mentionnés dans cette liste sont des œuvres littéraires. Le document complémentaire, intitulé « Pourquoi et comment s’est opérée la sélection ?« , est plus précis encore. Il indique que face à « la grande créativité et le caractère proliférant » de « l’édition jeunesse », qui peuvent « déstabiliser ou même rebuter des adultes et des enfants éloignés culturellement de leur usage », l’institution se devait d’opérer une sélection raisonnée. Les deux albums cités sont présents sur cette liste. En résumé, lorsqu’Olivier Barbarant cite De la petite taupe… ou L’Album d’Adèle, il évoque des œuvres qui, au sein de leur genre/medium, ont fait l’objet d’un tri qualitatif de la part de l’institution, tri sélectif leur octroyant de fait le statut de « classiques » constituant une « culture littéraire » commune. Bref : de la « grande littérature », même si elle est pour les tout petits. Notons au passage que, de manière assez étrange et qui mériterait qu’on s’y arrête, les auteurs d’albums sont finalement plus facilement reconnus par l’institution que ceux qui écrivent des romans pour les enfants : Tomi Ungerer recevra la légion d’honneur ce 1er janvier 2018…
À ma droite, les romans choisis par Olivier Barbarant pour sa critique, qui sont :
- La série Le Club des Cinq (citée pendant trois paragraphes) ;
- La série de fantasy L’Épouvanteur de Joseph Delaney (traduction Marie-Hélène Delval, 12 tomes parus chez Bayard depuis 2005) ;
- La série policière Cherub de Robert Muchamore (traduction Antoine Pinchot, 12 + 5 tomes parus chez Casterman depuis 2007) ;
- La saga de fantasy Harry Potter ;
- La série de fantasy plus enfantine La Cabane magique créée par Mary Poper Osborne (traduction Marie-Hélène Delval, 51 tomes parus chez Bayard depuis 2002).
Autrement dit, Olivier Barbarant compare ce que l’institution littéraire considère comme le plus légitime (des œuvres présentes sur les listes de recommandations édictées par le Ministère de l’Éducation Nationale dans le cadre d’une formation à la culture littéraire) et ce que la même institution considère traditionnellement comme le plus illégitime, au moins pour deux raisons : ce sont des textes appartenant à la littérature dite « de genre » (policier, fantasy) ; ce sont des œuvres sérielles. C’est pour moi l’occasion rêvée de faire de la publicité pour l’excellent ouvrage de mon ami Matthieu Letourneux (tiens, lui aussi normalien, agrégé, titulaire d’une thèse… et professeur d’université), Fictions à la chaîne. Littératures sérielles et culture médiatique.
Comparer Ponti et La Cabane magique, c’est un peu comme si on établissait une comparaison entre Les Misérables de Victor Hugo et Une Indomptable Captive de Denise Lynn paru dans la série « Les Historiques » des éditions Harlequin : au regard de l’institution d’où émane le jugement critique, la comparaison n’a pas grand sens, tant sont déséquilibrés les indicateurs de valeur. Si Olivier Barbarant avait voulu faire mouche, il lui fallait choisir, dans le domaine du roman pour les 8-15 ans, des œuvres elles aussi célébrées par la critique (elle existe) et les instances de légitimation scolaire. Or choisis pour leur extraordinaire éloignement de tous les critères de validation de l’institution littéraires, ces textes ne pouvaient que susciter le mépris de l’auteur de l’article. Il a dès lors beau jeu d’accumuler les griefs :
- ces textes ne témoignent d’aucune des marques de respect que l’édition doit à la clôture des œuvres de « grande littérature ». À cet égard, de manière totalement contradictoire, Olivier Barbarant s’émeut de l’irrespect dont seraient victimes les éditions actuelles du Club des cinq… semblant tout ignorer des manipulations auxquelles ces textes ont donné lieu dès leur première parution en France2, tout aussi du mépris avec lequel sont en général traitées les traductions dans l’édition pour la jeunesse3;
- ces textes sacrifieraient à la tendance actuelle à l’affadissement des marques d’éloignement temporel, au nom d’un « politiquement correct » pudibond ;
- ces textes survaloriseraient une identification immédiate du lecteur ;
- ces textes véhiculeraient des valeurs manichéennes simplistes ;
- ces textes seraient présentés, de manière simplificatrice, sous l’angle du « thème » traité.
Toutes ces critiques, au demeurant, sont fort justes. Mais les formuler relève en réalité de l’évidence : ce qu’Olivier Barbarant énumère, ce sont tout simplement quelques-unes des marques d’appartenance de ces textes à l’univers de la production sérielle commerciale. L’auteur manque ici sa cible, en tentant de nous convaincre que ne sont pas littéraires des textes qui n’affichent en réalité aucune prétention à la littérarité…
 C’est dommage : en ne consacrant sa critique qu’à des textes appartenant explicitement à la frange sérielle de l’édition pour la jeunesse – c’est-à-dire celle qui ne nécessite pas la médiation de l’école pour séduire son lecteur – il rate l’occasion de porter un regard véritablement critique sur cette autre part de l’édition enfantine, celle qui, de l’aveu même de ses auteurs et éditeurs, a une réelle prétention à la littérarité. C’est là qu’une comparaison avec la créativité remarquable de certains albums pour jeunes enfants aurait eu son sens, c’est là que la mise en balance avec les œuvres de la « grande littérature » aurait pu permettre de faire avancer la réflexion contemporaine sur l’écriture adressée aux enfants et aux pré-adolescents. Olivier Barbarant manque donc son objectif. Peut-être est-ce dû en partie au fait qu’il ne prend aucunement la peine de se renseigner sur le sujet qui forme le cœur de son article : ses références bibliographiques renvoient presque exclusivement à des sites internet d’information brève4…
C’est dommage : en ne consacrant sa critique qu’à des textes appartenant explicitement à la frange sérielle de l’édition pour la jeunesse – c’est-à-dire celle qui ne nécessite pas la médiation de l’école pour séduire son lecteur – il rate l’occasion de porter un regard véritablement critique sur cette autre part de l’édition enfantine, celle qui, de l’aveu même de ses auteurs et éditeurs, a une réelle prétention à la littérarité. C’est là qu’une comparaison avec la créativité remarquable de certains albums pour jeunes enfants aurait eu son sens, c’est là que la mise en balance avec les œuvres de la « grande littérature » aurait pu permettre de faire avancer la réflexion contemporaine sur l’écriture adressée aux enfants et aux pré-adolescents. Olivier Barbarant manque donc son objectif. Peut-être est-ce dû en partie au fait qu’il ne prend aucunement la peine de se renseigner sur le sujet qui forme le cœur de son article : ses références bibliographiques renvoient presque exclusivement à des sites internet d’information brève4…
Que fait l’école ?
Le chapeau de l’article nous promettait des révélations sur l’infiltration de l’univers scolaire par ces « mauvaises lectures ». Le sujet n’arrive finalement que dans les trois derniers paragraphes. À la charge contre la « mauvaise » littérature succède une critique contre les menées des éditeurs, cherchant à pénétrer les classes avec leur marchandise de piètre qualité. Mais que nous révèle Olivier Barbarant ? Que les éditeurs, qui ont parfaitement compris l’intérêt économique que représente la « prescription » scolaire, rivalisent d’inventivité pour séduire les enseignants, et pour les convaincre qu’ils pourraient utiliser leurs livres dans les classes dont ils ont la charge. Olivier Barbarant feint de s’en étonner, voire de s’en indigner. C’est pourtant lui, qui, dès son 2e paragraphe, a rappelé que l’édition pour la jeunesse était un formidable marché. Or l’Éducation Nationale est précisément un formidable client !
 Rappelons que, cette année encore, le classement datalib confirme que parmi les 100 meilleures ventes en jeunesse figurent quelques « long sellers » qui doivent tout de leur succès à la prescription scolaire : Vendredi ou la vie sauvage (en 6e position 47 ans après sa première publication), L’Odyssée d’Homère dans la version donnée par l’École des Loisirs (11e position), Le Petit Prince (24e), etc.5 Le monde scolaire est un marché, l’édition est un commerce : pourquoi s’étonner que les éditeurs cherchent à convaincre leurs clients enseignants de la qualité de leurs produits, en faisant ce que tout bon commercial doit faire, persuader son interlocuteur qu’il a un évident besoin de ce produit qui lui rendra d’éminents services ?
Rappelons que, cette année encore, le classement datalib confirme que parmi les 100 meilleures ventes en jeunesse figurent quelques « long sellers » qui doivent tout de leur succès à la prescription scolaire : Vendredi ou la vie sauvage (en 6e position 47 ans après sa première publication), L’Odyssée d’Homère dans la version donnée par l’École des Loisirs (11e position), Le Petit Prince (24e), etc.5 Le monde scolaire est un marché, l’édition est un commerce : pourquoi s’étonner que les éditeurs cherchent à convaincre leurs clients enseignants de la qualité de leurs produits, en faisant ce que tout bon commercial doit faire, persuader son interlocuteur qu’il a un évident besoin de ce produit qui lui rendra d’éminents services ?
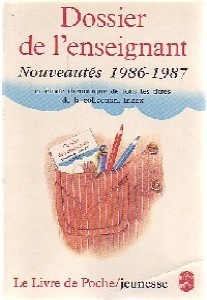 La démarche est loin d’être nouvelle. Lorsque la réforme Haby, en 1975, met en place le collège unique, les enseignants du secondaire voient soudain déferler dans leurs classes une population d’enfants n’ayant pas tous les pré-requis nécessaires à l’absorption immédiate des classiques de la « grande » littérature française jusque là au programme. Le passage par l’usage en classe d’ouvrages de littérature pour la jeunesse s’impose assez vite comme une manière de transmettre des connaissances et des compétences littéraires, et d’aménager la transition, pour des enfants qui ne sont pas issus des milieux socio-culturels les plus lettrés, vers la littérature générale. Or les enseignants de ce mi
La démarche est loin d’être nouvelle. Lorsque la réforme Haby, en 1975, met en place le collège unique, les enseignants du secondaire voient soudain déferler dans leurs classes une population d’enfants n’ayant pas tous les pré-requis nécessaires à l’absorption immédiate des classiques de la « grande » littérature française jusque là au programme. Le passage par l’usage en classe d’ouvrages de littérature pour la jeunesse s’impose assez vite comme une manière de transmettre des connaissances et des compétences littéraires, et d’aménager la transition, pour des enfants qui ne sont pas issus des milieux socio-culturels les plus lettrés, vers la littérature générale. Or les enseignants de ce mi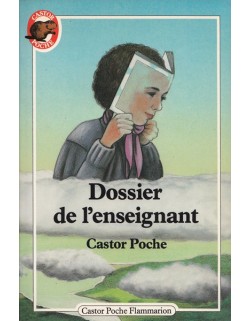 lieu des années 1970 n’ont pas reçu de formation à la littérature pour la jeunesse, qui à cette époque est évidemment absente des cursus universitaires. Ils se forment donc « sur le tas », ce que les éditeurs comprennent instantanément. Très vite, ces derniers publient des « dossiers de l’enseignant », brochures du même format que les collections de poche accessibles aux budgets scolaires étiques, qui présentent une partie de leur catalogue et facilitent le travail des enseignant en indiquant d’emblée quel usage scolaire pourrait être fait de chacun des textes mis en avant (thématiques, disciplines concernées, niveau scolaire, lien avec les programmes).
lieu des années 1970 n’ont pas reçu de formation à la littérature pour la jeunesse, qui à cette époque est évidemment absente des cursus universitaires. Ils se forment donc « sur le tas », ce que les éditeurs comprennent instantanément. Très vite, ces derniers publient des « dossiers de l’enseignant », brochures du même format que les collections de poche accessibles aux budgets scolaires étiques, qui présentent une partie de leur catalogue et facilitent le travail des enseignant en indiquant d’emblée quel usage scolaire pourrait être fait de chacun des textes mis en avant (thématiques, disciplines concernées, niveau scolaire, lien avec les programmes).
 Lorsque paraissent les programmes de 2002 pour le cycle 3 de l’école élémentaire (à l’époque, il ne déborde pas sur le collège), les éditeurs renforcent leur stratégie d’accompagnement des enseignants, en éditant des catalogues dédiés à ceux de leurs titres apparaissant dans les listes d’ouvrages conseillés. C’est notamment le cas de l’École des Loisirs, dont les brochures sont d’ailleurs remarquablement réalisées.
Lorsque paraissent les programmes de 2002 pour le cycle 3 de l’école élémentaire (à l’époque, il ne déborde pas sur le collège), les éditeurs renforcent leur stratégie d’accompagnement des enseignants, en éditant des catalogues dédiés à ceux de leurs titres apparaissant dans les listes d’ouvrages conseillés. C’est notamment le cas de l’École des Loisirs, dont les brochures sont d’ailleurs remarquablement réalisées.
Puis les éditeurs investissent le net, et ouvrent des sites spécifiquement dédiés aux usages scolaires de leurs ouvrages: le « Cercle Gallimard de l’enseignement » et ses fiches pédagogiques, le « Blog de l’École des Lettres » de l’École des Loisirs, qui cette semaine conseille, puisqu’une adaptation cinématographique des Quatre filles du docteur March est programmée sur Arte le 2 janvier, d’étudier la version publiée dans sa collection « classiques abrégés », le site Enseignants Flammarion et ses « livrets pédagogiques »,…
 Plus encore : dès 2003, le Syndicat National de l’Édition lance ses « Parcours Professionnels pour la Lecture Jeunesse », rencontres gratuites, organisées en province par le SNE, avec le concours bienveillant de l’Éducation Nationale. Ces journées proposent aux enseignants qui pour l’occasion, bénéficient d’une autorisation d’absence, une série de tables rondes, conférences et forums, et bien entendu, stands d’éditeurs. Quelques années après leur lancement, ces journées sont rebaptisées « Rencontres avec les Éditeurs de littérature jeunesse » puis « Rencontres jeunesse en région » : parce que le terme « professionnels » avait fini par choquer, dans le sens où l’on ne savait trop quelle « profession », celle de l’éditeur ou celle de l’enseignant, était mise en valeur lors de ces journées ?…
Plus encore : dès 2003, le Syndicat National de l’Édition lance ses « Parcours Professionnels pour la Lecture Jeunesse », rencontres gratuites, organisées en province par le SNE, avec le concours bienveillant de l’Éducation Nationale. Ces journées proposent aux enseignants qui pour l’occasion, bénéficient d’une autorisation d’absence, une série de tables rondes, conférences et forums, et bien entendu, stands d’éditeurs. Quelques années après leur lancement, ces journées sont rebaptisées « Rencontres avec les Éditeurs de littérature jeunesse » puis « Rencontres jeunesse en région » : parce que le terme « professionnels » avait fini par choquer, dans le sens où l’on ne savait trop quelle « profession », celle de l’éditeur ou celle de l’enseignant, était mise en valeur lors de ces journées ?…
La mise en place progressive de ces stratégies commerciales pose en effet question. Loin de m’émouvoir, comme le fait Olivier Barbarant, de cette « pression considérable » exercée par les éditeurs sur le monde enseignant, je m’interroge sur le laisser-faire de l’institution éducative. Certes, les perspectives « pédagogiques » proposées par certaines de ces fiches produites par les éditeurs ont de quoi agacer, par leur pauvreté et l’étroitesse de leurs perspectives. Mais après tout, ces éditeurs font leur métier : éditer des livres, puis tenter de les vendre, le plus possible, au plus grand nombre possible d’acheteurs de tous profils. Enseigner n’est pas leur métier.
Il se trouve, en revanche, que c’est celui des profs de collège à qui s’adressent ces fiches pédagogiques. Si ces derniers se laissent prendre aux suggestions réductrices des commerciaux engagés par les éditeurs, qui faut-il blâmer ? Les éditeurs, qui font leur métier, ou les enseignants, qui renoncent aux exigences que devrait impliquer le leur ? Plus précisément encore, à supposer que des enseignants se laissent prendre aux pièges grossiers que leur tendent les documents « pédagogiques » produits par des éditeurs de fiction commerciale, qui faut-il incriminer : ces enseignants, ou l’institution qui ne leur a pas proposé de formation initiale leur permettant de s’initier à la critique de littérature pour la jeunesse, qui ne leur offre aucune formation continue sur ce sujet, une institution qui a le frontt, sur son propre site, de renvoyer les enseignants à qui elle ne procure pas de formation vers un MOOC financé par une université étrangère (Liège), MOOC que les enseignants devront suivre sur leur temps libre ?
Ces deux derniers paragraphes posent un autre problème. Olivier Barbarant qui, en tant qu’inspecteur, a accès à ce qui se passe dans les classes, n’offre pourtant aux lecteurs du Monde diplomatique aucun exemple de pratique pédagogique réellement observée. Existe-t-il des classes dans lesquelles on enseigne l’éducation morale et civique à partir de Chérub ? A-t-il observé des séquences d’enseignement visant à découvrir Léonard de Vinci à travers un épisode de La Cabane magique ? L’article reste elliptique : seules sont analysées les formules extraites de ces fiches soi-disant « pédagogiques ». Or ces dernières font partie d’un ensemble de discours accompagnant la promotion d’un catalogue. De quelle manière ces formules révèlent-elles ce qui se passe réellement dans les classes ? Probablement, à peu près de la même manière que les pages des catalogues de prêt-à-porter révèlent la manière de s’habiller des vraies gens, dans la vraie vie… Il aurait été infiniment plus fécond que l’auteur de l’article, qui est inspecteur, révèle aux lecteurs de la revue ce qu’il a pu effectivement observer comme pratiques dans des classes où l’enseignement littéraire se fait à partir d’œuvres de littérature pour la jeunesse : les objectifs, imaginés par les concepteurs des programmes à partir d’un corpus de « grande littérature », peuvent-ils être atteints si l’on emploie comme support d’étude un roman contemporain écrit pour la jeunesse ? Que manque-t-il éventuellement ? Que se produit-il en termes d’interactions entre les jeunes lecteurs et les textes ? Qu’en tirer comme conclusion, quand on est inspecteur de lettres ? Une seconde fois, le lecteur a l’impression que l’auteur de l’article a manqué son but, et que sa position professionnelle lui offrait une visibilité qu’il ne met pas au service de son public.
Le « moyen de trier »
L’article d’Olivier Barbarant, loin finalement de nous révéler, comme promis en introduction, les effarantes menées colonisatrices des éditeurs sur le monde scolaire, se termine par cet appel :
« beaucoup trop de ce qui touche les collégiens et les lycéens se trouve ainsi coincé entre un air du temps moralisateur et les règles du marche, propices à une intarissable sociologie de patronage dans laquelle parents comme école devraient d’urgence trouver le moyen de trier. »
Cette formule de clôture fait émerger quelques problématiques qu’il aurait été passionnant de voir réellement abordées dans l’article. Par exemple, le moralisme diffus d’une partie de la littérature pour la jeunesse contemporaine – ce qui est, à ma connaissance, un sujet réellement tabou. La représentation sociologique qui a cours dans bon nombre de romans pour enfants, et qui mériterait un examen critique sérieux. La confusion généralisée, aujourd’hui, entre « l’édition » pour la jeunesse (qui va bien), et la « littérature pour la jeunesse » (dont les auteurs ne cessent, eux, de se plaindre qu’ils ne peuvent pas en vivre – comme les auteurs de littérature pour adultes exigeante ?…). Quel dommage qu’il ne les ait pas traitées. Quel dommage que Le Monde diplomatique, comme finalement tous les journaux, n’ait fait que survoler le sujet.
Arrêtons-nous sur les derniers mots de l’article. Olivier Barbarant évoque l’urgence de fournir aux parents et enseignants des « moyens de trier » au sein de la proliférante production de livres pour la jeunesse. Le « moyen de trier » ? Ça s’appelle de la formation. N’est-ce pas précisément ce qu’un inspecteur devrait s’employer à aménager pour les enseignants dont il a la charge ? Voilà un beau chantier pour l’année qui s’ouvre !
- ce qui est, historiquement, un contresens…
- voir à ce sujet Sophie Heywood, « Pippi Longstocking, Juvenile Delinquent? Hachette, Self-Censorship and the Moral Reconstruction of Postwar France », Itinéraires [En ligne], 2015-2 | 2016, mis en ligne le 15 février 2016, consulté le 31 décembre 2017. URL : http://journals.openedition.org/itineraires/2903 ; DOI : 10.4000/itineraires.2903 – merci à Mathilde Lévêque qui, sur sa page Facebook, a eu la présence d’esprit de renvoyer vers cette référence
- voir pour cela les actes du passionnant colloque Traduire les livres pour la jeunesse : enjeux et spécificités, sous la direction de Nic Diament, Corinne Gibello et Laurence Kiéfé, Hachette, BnF/CNLPJ –la Joie par les livres, 2008, ainsi que, plus récent, l’ouvrage de synthèse de Virginie Douglas, États des lieux de la traduction pour la jeunesse, Presses Universitaires de Rouen et du Havre, 2015 – bibliographie plus complète sur le Magasin des Enfants
- LivresHebdo.fr, Actuallitte.com, sudouest.fr
- classement daté de cette semaine
Par Cécile Boulaire, Maitre de conférence à l’Université François-Rabelais (Tours), cecile.boulaire@univ-tours.fr.
Chronique publiée le 29 janvier 2018

