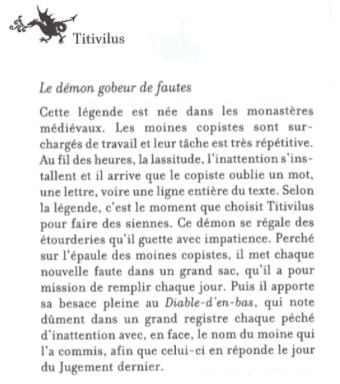Des chevaliers et des enfants ou l’art de réinvestir l’univers arthurien avec talent (partie 2 : Quelle épique époque opaque !)
A. Pouget, 2013, Quelle épique Epoque opaque !, Paris : Casterman. ©
Cette seconde partie de chronique, faisant suite à la publication de la semaine précédente (voir ici), vise à présenter des ouvrages de littérature de jeunesse qui ont su s’inspirer de l’univers arthurien de manière brillante. Aux antipodes d’adaptations de textes médiévaux poussiéreuses, ces ouvrages constituent de réelles créations qui savent remettre au goût du jour tout un pan de notre patrimoine.
Après s’être intéressés à l’album Les P’tites Poules, la Bête et le Chevalier (dès 5 ans), découvrons Quelle épique époque opaque !, un roman pour les plus grands (10 ans) s'adressant également aux adultes qui ne resteront pas indifférents aux nombreux effets comiques que recèle cet ouvrage remarquable.
Quelle épique époque opaque ! pour les plus grands
Quelle Epique époque opaque ! Le titre du roman donne le ton d’un récit qui fait la part belle, certes, à l’aventure chevaleresque (épique) et au Moyen Âge (époque), mais également à l’opacité du langage (opaque), source de nombreux malentendus entre les personnages ou d’écarts de style qui provoquent bien souvent le (sou)rire du lecteur. Philibert, jeune chevalier, nourri de lectures chevaleresque, mais n’étant jamais sorti de son château, accepte une quête lancée par Merlin. Son écuyer, Cornebulle, comprenant souvent de travers ce que son maître dit, l’accompagne et décide d’écrire la légende de celui-ci. Le chevalier et son valet partent alors à l’aventure pour ramener à Merlin un démon gobeur de fautes d’orthographe, susceptible de mettre à mal la réputation du célèbre enchanteur qui n’a pas su se montrer toujours attentif à la complexité de la langue française lors de la rédaction d’un de ses manuscrits.
Tout au long du récit, le chevalier et son écuyer vont séjourner dans des lieux tout droit sortis du Moyen Âge, qu’il s’agisse de lieux ayant existés comme le scriptorium (le lieu où les moines copistes rédigeaient les manuscrits) ou des lieux légendaires comme le Val-sans-Retour (un lieu d’où aucun chevalier ne revenait, tous étaient retenus prisonniers de la fée Morgane qui avait vécu une aventure amoureuse douloureuse avec un chevalier). Les personnages rencontrés, adjuvants ou opposants, sont également empruntés à la culture médiévale. Le démon Titivilus, gobeur de fautes d’orthographe qu’il rapporte au diable, symbolisait aux yeux des moines copistes le péché d’acédie (paresse) auquel il s’agissait d’échapper durant de longues heures de travail. Les lavandières, comme Cornebulle l’explique à son maître, sont, selon la légende bretonne, des revenantes qui prennent la vie des passants les aidant à tordre leur linge/linceul (p. 118). En fin d’ouvrage, l’auteure précise que son récit, loin d’être le produit de l’imagination saugrenue de Cornebulle, s’inspire « de véridiques légendes attestées par les plus savants historiens » (p. 175), en témoigne le glossaire (pp. 176-186) que l’auteure, elle-même historienne, met à disposition du lecteur.
A. Pouget, 2013, Quelle épique Epoque opaque !, Paris : Casterman. ©
Si les créatures et lieux étonnants qui peuplent le récit ont une prétention didactique, développer les connaissances du lecteur à propos de la culture médiévale, ils servent également à présenter un univers littéraire merveilleux. En effet, l’univers du récit est composé, entre autres, d’arbres qui retiennent prisonniers les oiseaux jusqu’à ce qu’ils dessèchent, de feuilles d’arbres vivantes qui se déplacent à l’image de petits animaux et mieux encore, aux yeux du lecteur-élève, d’un vilain démon au nom de Titivilus, amateur de fautes d’orthographe. Les légendes médiévales permettent ainsi de donner une coloration merveilleuse au récit et celle concernant Titivilus, au fondement de la quête des héros, est également au cœur d’un thème qui traverse le récit : le rapport à la langue.
Le langage comme source de malentendus et d'effets comiques
Ce rapport à la langue problématique est présent tout au long du récit et se manifeste de différentes manières, comme lorsque Philibert et son écuyer cherchent à capturer le démon Titivilus. C’est Cornebulle qui élabore un plan efficace, grâce à une imagination peu commune. L’écuyer écrit les mots de la langue française les plus longs, afin que le démon prenne du temps pour les lire et y repérer les erreurs d’orthographe. Ce dernier, perché pendant un long moment sur l’épaule de l’écuyer, sera alors facilement capturable. Le plan fonctionne à merveille. Ensuite, Philibert prend connaissance de mots écrits par Cornebulle pour piéger le démon : « Le noble et beau Philibert, qui comme chacun le sait est atteint d’hippopotomonstrosesquippedaliophobie...» (p. 99). Il ne peut que s’en étonner. Son écuyer lui explique à raison qu’il s’agit du mot savant qui désigne la peur des mots trop longs. Le lecteur, lui, a l’impression que Cornebulle invente des mots délirants. A l’image de Philibert, il sera bien surpris d’apprendre que Cornebulle utilise et orthographie ce genre de mot de manière adéquate, alors qu’il écrit « elle attendit sans se lacer » ou encore « l’étau se ressert » (p. 100). Car, oui, ce qui fait tout l’intérêt de l’écuyer réside dans son incapacité à saisir les subtilités du langage, qu’il s’agisse d’homophonie, de polysémie ou encore du sens figuré de certaines expressions. Le langage devient alors vecteur d’incompréhension, créant certains malentendus qui ont tendance à agacer Philibert.
C’est le cas quand le chevalier demande à son écuyer de lui confier ses desseins pour capturer le démon. Cornebulle lui répond : « Mes dessins, sire ? Mais je les ai laissés à l’abbaye de Paimpont ! C’est de mon plan que je voulais parler ! ». (p. 95). En début de récit, lorsque l’émissaire amène un pli à remettre en main propre à Philibert, Cornebulle s’offense du fait qu’on ne veuille lui remettre ce pli, sous prétexte que ses mains ne sont pas propres (p. 12). L’écuyer a également du mal à distinguer le sens littéral du sens figuré lorsqu’il se demande comment un humain normalement constitué peut dormir sur ses deux oreilles (p. 47). Ces malentendus, dus à la difficulté de maîtriser tous les aspects de la langue française, ne peuvent que faire sourire le lecteur. Ils font de Cornebulle un personnage peu adapté aux situations de communication qu’il rencontre, pas très éloigné des personnages de Perceval et Karadoc de la série Kaamelott qui ne comprennent rien aux expressions imagées, aux mots compliqués et qui passent leur temps à les utiliser à tort et à travers, ce qui a la don d’agacer le roi Arthur.
Le passage consacré à l’utilisation du terme polyglotte illustre très bien ce rapport au langage problématique, producteur de scènes comiques (pp. 115-116) :
- Décidément sire, on baragouine tous les latins en ces lieux ! Il va falloir que je devienne multilinglotte ! grinça Cornebulle.
- Polyglotte, rectifia son camarade de chevauchée.
- Poli, je m’efforce de l’être en toutes circonstances, sire...
- En ce bas monde, il y a décidément les héros et les zéros, et en cela nous nous complétons bien toi et moi ! soupira Philibert, avant d'ajouter : Polyglotte veut dire qu'on parle plusieurs langues !
- Mais « multi » aussi, sire ! […]
- Certes mon brave ; mais « multilinglotte » n'existe pas encore dans notre belle langue ! […]
- Mais alors, si je ne parle qu'une seule langue, je suis unilinglotte ou solilinglotte?
Tout en faisant sourire le lecteur, cette scène peut aussi lui permettre d’acquérir la connaissance du terme adéquat visant à désigner une personne qui maîtrise l’utilisation de plusieurs langues. Cette composante didactique du roman apparaît également lorsque Philibert explique à Cornebulle l’importance de la ponctuation (pp. 84-85) :
- Si je puis me permettre, cher biographe, il serait peut-être bon qu'ici ou là tu songes à soigner ta ponctuation ? […]
- Et qu'est-ce qui vous ennuie, sire, dans ma ponctuation ?
- C'est que... euh... Elle est un peu... composite.
Soucieux de prouver la justesse de son propos, le prince vint s'asseoir à côté de son compagnon d'aventure ; se saisissant d'une chute de parchemin, d'un calame, qu'il trempa dans l’encrier, il écrivit : « Cornebulle dit Philibert est un crétin. »
À son écuyer, qui lorgnait par-dessus son avant-bras d'un air dubitatif, le chevalier expliqua d'une petite voix doucereuse :
- Fidèle ami, prenons cette succession de mots... À présent, vois, j'y ajoute la ponctuation. Cela nous donne, dans le premier cas : « Cornebulle dit, Philibert est un crétin »... Et dans le second - qui me semble plus judicieux : Cornebulle, dit Philibert, est un crétin... Cela suffit-il à illustrer l’importance de la ponctuation ?
Dans ce passage, Philibert explique comment le simple placement de virgules peut impacter le sens d’une phrase. Le choix de la phrase permet à Philibert de rire une nouvelle fois de Cornebulle, invitant le lecteur à faire de même. A ce sens, le roman d’Anne Pouget semble tenir du registre didactico-comique.
Ce rapport au langage peu conventionnel, voire problématique, bien qu’il soit principalement associé au personnage de Cornebulle, transparaît également via le discours amoureux de Philibert. La poésie du chevalier laisse effectivement le lecteur perplexe, lorsque le jeune homme complimente sa dulcinée : « Vous êtes lumineuse comme mes éperons de cuivre lorsque mon écuyer les a astiqués. Et vos dents ! Aussi bien cirées que le parquet de ma chambre » (p. 45). Les comparaisons que Philibert utilise pour célébrer la beauté de Béatrice sont inadaptées du fait qu’il associe la beauté physique de la demoiselle (teint, dents) à des objets banals, impropres à célébrer celle-ci. Philibert, comme la suite de son discours le confirmera, est incapable de s’exprimer dans un registre lyrique, ce qui n’empêchera toutefois pas Béatrice de tomber sous le charme de sa « poésie ».
Néanmoins Cornebulle reste la figure comique principale du récit et si le lecteur peut parfois trouver que Philibert se montre un peu rude à l’égard de son écuyer, la fin du récit donne raison au chevalier. Peu conscient de la valeur du cadeau de Merlin (rien moins que le Graal), l’écuyer échange celui-ci contre deux chevaux. Par cet acte manquant de clairvoyance, Cornebulle peut à nouveau être associé au personnage de Perceval, qui, dans Le Conte du Graal de Chrétien de Troyes, voit le Graal, mais ne le reconnaît pas comme tel. Si dans le récit médiéval, le fait que Perceval passe à côté du Graal est dû à un péché que le chevalier a commis, dans Quelle Epique époque opaque !, il s’agit simplement de la manifestation de la bêtise de Cornebulle, comme l’évoque Philibert. La faute est moindre, d’autant plus que c’est elle qui va finalement pousser Philbert à partir … à la quête du Graal. La bêtise de l’écuyer constitue alors le fondement d’une nouvelle quête et institue le roman comme la genèse d’une aventure épique à venir, déjà maintes fois racontée par les auteurs médiévaux et ceux qui s’en inspirèrent.
Pour terminer, la question du courage, comme dans Les P’tites Poules, la Bête et le Chevalier, est abordée. Si elle n’est pas dévalorisée au profit d’autres valeurs, elle est toutefois remise en question par Cornebulle, lorsqu’il reformule anachroniquement une citation empruntée à Corneille (pp. 128-129) :
- Pourtant [affirma Philibert], je me console en me disant que pour devenir un héros, il faut parcourir le monde en quête d'aventure ! « A vaincre sans péril, on triomphe sans gloire », avait dit le Cid.
L'écuyer massa ses pieds endoloris.
- Ouais, ben moi je dirais plutôt qu' « à vaincre sans péril, on prend moins de risques » !
L’écuyer propose une vision de l’aventure chevaleresque beaucoup moins épique que son maître, mais certes plus pragmatique.
Pour finir…
Le trajet proposé au fil de cette double chronique avec Les P’tites Poules, la Bête et le Chevalier, puis Quelle épique époque opaque !, dévoile comment la littérature de jeunesse réinvestit avec intelligence et de manière amusante tout un pan de notre patrimoine littéraire. Le réemploi de l’univers arthurien permet de faire vivre des aventures fabuleuses aux lecteurs alors que l’utilisation parodique de ce même univers vise à questionner l’actualité des valeurs qui animent les chevaliers, mais aussi à produire divers effets comiques. Ces ouvrages, de par leur qualité, gagneraient à être exploités en classe non pas uniquement en tant que récits d’aventure passionnants ou comme garants d’une culture commune, mais surtout en tant que réécritures arthuriennes pour sensibiliser les élèves à toutes sortes de phénomènes transtextuels dont la composante ludique semble indéniable.
Par Vanessa Depallens, assistante-doctorante à la HEP Vaud, vanessa.depallens@hepl.ch
Chronique publiée le 10 avril 2017